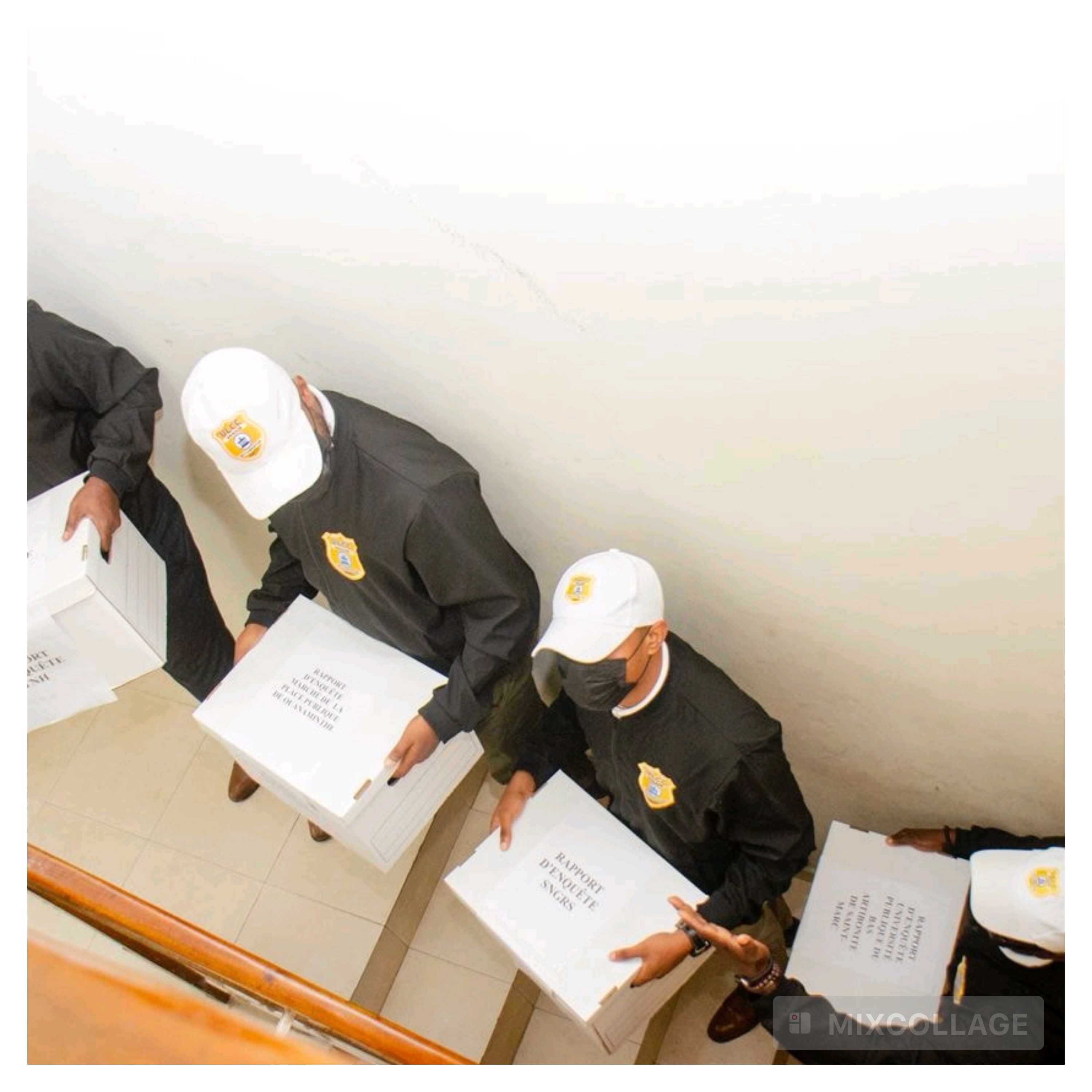Analyser les implications de l'inclusion de l'article 59 dans la nouvelle constitution d'Haïti révèle un risque profond pour la nation, particulièrement dans le contexte de ses luttes historiques contre le néocolonialisme et l'exploitation étrangère. Cet article, qui accorde des droits de propriété aux étrangers, évoque un héritage troublant qui a frappé Haïti depuis son émergence en tant que nation souveraine.
Haïti, pays riche en ressources et jouissant d'une position stratégique, a toujours été une cible pour les intérêts étrangers. La récurrence de dispositions similaires dans les constitutions précédentes, de 1918 à aujourd'hui, rappelle de manière saisissante comment ces politiques peuvent faciliter le contrôle étranger sur les terres et les ressources haïtiennes. Par exemple, la Constitution de 1918 stipule dans l'article 5 : «Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux sociétés formées par des étrangers pour les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'enseignement ». Chaque itération constitutionnelle reflète un schéma qui sape la souveraineté nationale, permettant aux puissances extérieures de manipuler la richesse d'Haïti à leur propre avantage, tandis que la population locale souffre des conséquences.
La Constitution de 1944, de manière similaire, affirme dans son article 8 que «Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux Sociétés formées par des étrangers seulement pour les besoins de leurs demeures, et de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou pour leurs établissements d'enseignement légalement autorisés». L'histoire de ce texte révèle que ces dispositions ont souvent été adoptées durant des périodes d'occupation étrangère, comme la présence militaire américaine de 1915 à 1934. Pendant ce temps, la souveraineté d'Haïti a été gravement compromise, entraînant des ravages sociaux et économiques. L'inclusion de l'article 59 dans le projet constitutionnel actuel risque de perpétuer ce cycle d'exploitation, car elle ouvre la porte aux entités étrangères pour établir un pied-à-terre en Haïti sous le couvert d'investissement et de développement.
La situation actuelle à Port-au-Prince, où la violence des gangs prolifère au milieu des ruines d'une ville jadis florissante, témoigne des conséquences de la négligence des intérêts nationaux. La présence de sociétés et d'intérêts étrangers peut exacerber les troubles locaux, car l'exploitation des ressources entraîne souvent le déplacement et la souffrance supplémentaire du peuple haïtien. En accordant des droits de propriété aux étrangers, comme le stipule *l'article 8* de la *Constitution de 1939*, qui fait écho aux dispositions antérieures, Haïti risque de devenir un simple pion dans le jeu de pouvoir mondial, avec ses citoyens relégués sur le banc de touche, spectateurs de leur propre destin.
De plus, le contexte historique de ces articles met en lumière un schéma persistant : la promesse de développement économique par le biais d'investissements étrangers se solde souvent par une désillusion, laissant les communautés fragmentées et appauvries. La population haïtienne a déjà enduré trop de pertes, et permettre à cet article de passer pourrait signifier un pas irréversible vers une marginalisation et une dépossession accrues.
La Constitution de 1932 réitère également en son article 5 que «Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux sociétés formées par des étrangers pour les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'enseignement». Ce schéma est clair : chaque cadre constitutionnel a fait écho au même sentiment, renforçant l'idée que les intérêts étrangers peuvent dicter les termes en Haïti, souvent au détriment de son peuple.
En conclusion, l'inclusion potentielle de l'article 59 dans la constitution d'Haïti constitue une grave menace pour la souveraineté et l'avenir de la nation. Alors que le pays lutte contre le spectre de l'intervention et de l'exploitation étrangères, il est impératif de rejeter les dispositions qui permettraient aux entités extérieures de saper l'intégrité d'Haïti. Le peuple haïtien doit s'unir dans sa résistance contre cette agenda néocolonial, garantissant que ses droits et ses ressources soient protégés pour les générations à venir. Ne pas le faire pourrait signifier la perte non seulement des terres et des ressources, mais de l'essence même de ce que signifie être haïtien.
Dr. James Joseph (Didi)