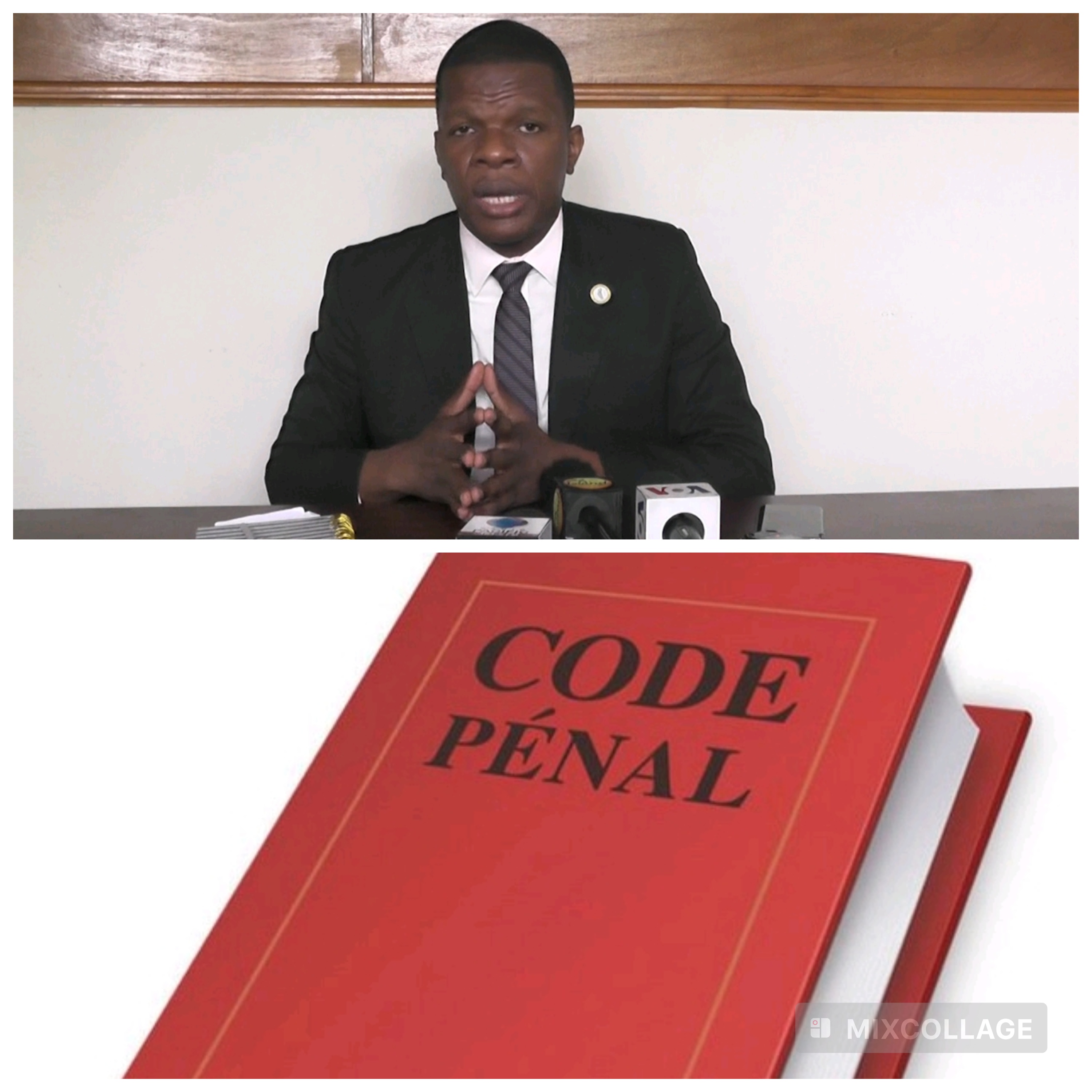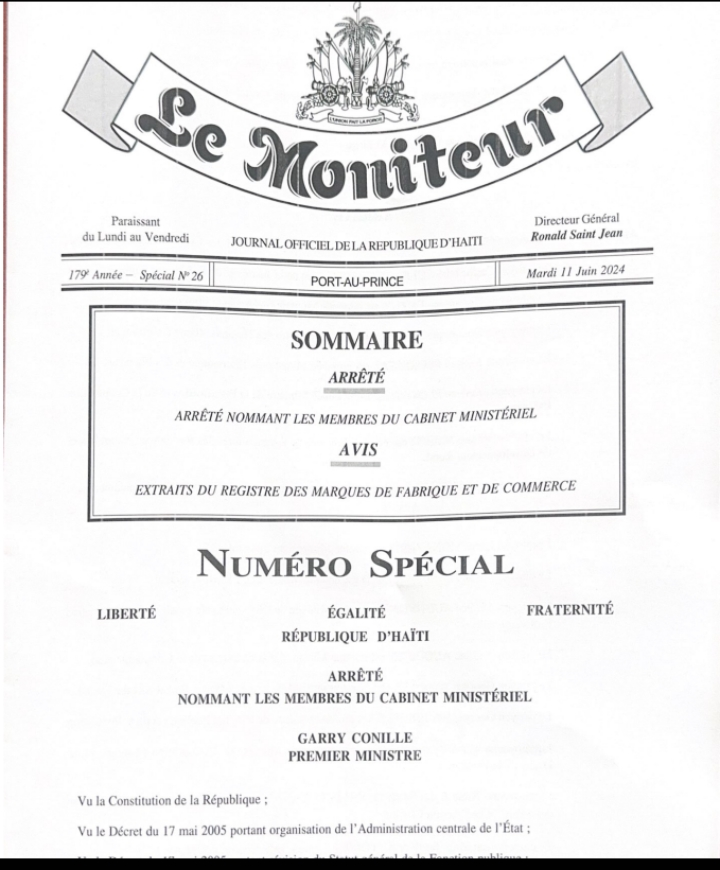Terre mal aimée, Terre généreuse, Terre clémente ; C’est ma terre, Mon pays, mon Haïti. Elle m’a tout donné : ma force, ma chaleur, ma joie de vivre. Toute dépouillée et enchaînée dans ses souffrances, elle me comble avec le peu de charme qui lui reste. Son soleil me donne chaque jour l’énergie nécessaire pour traverser les années et affronter les tribulations de la vie
C’est ce morceau de terre de la Caraïbe, petit en termes de superficie, appauvri de ses ressources par l’international et le statu quo local, mais très grand par son passé historique, qu’un séisme dévastateur de magnitude de 7.3 a ravagé le 12 janvier 2010. « Goudougoudou » a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes et détruit beaucoup de villes ou communes dans le département de l’Ouest, y compris Port-au-Prince, la capitale et bien entendu Léogâne, l'épicentre. En quelques secondes, le symbole de la liberté des peuples noirs était mis à genou.
Pendant des heures, l’État haïtien, déliquescent, était incapable non seulement d’apporter les premiers soins aux survivants, mais aussi de trouver les personnes coincées ou mortes sous les décombres. Face à l’ampleur d’une telle catastrophe et la paralysie du Léviathan haïtien, la solidarité de l’internationale était donc nécessaire. Entre cet espace de temps de l’immobilisme de l’État et l’attente de secours externes, ce qui a paru certainement durer une éternité, la population haïtienne a manifesté un courage, une solidarité ou une « Konbit » exemplaire pour soulager les siens ou utiliser tous les moyens artisanaux pour tirer leurs frères et sœurs piégés dans les décombres.
En attendant d’autres secours qui devaient arriver différents pays de la région, la République dominicaine, qui partage la frontière avec Haïti, était la première à pouvoir exprimer sa solidarité sur le terrain. Puis quelques heures plus tard, dans un élan de solidarité, d’autres équipes de secouristes internationaux étaient déjà au pays pour apporter leur aide à une nation désemparée. Vite en besogne, ces secouristes, en trouvant des blessés qui étaient encore sous les décombres et avec l’aide des médecins et infirmiers étrangers sur place, avaient vraiment exemplifié à un quelconque niveau le support de la communauté internationale dans les premiers moments d’urgences et avaient aussi sauvé beaucoup de vies.
Mais, au-delà des recherches de survivants encore sous les décombres, d’assistances humanitaires immédiates et la gestion des victimes, soit tuées ou handicapées, l’autre urgence était : la reconstruction. Pour répondre à ce problème, la communauté internationale avait mobilisé des soutiens immédiats pour aider les autorités locales dans le processus. Internationalement, des appels à l'aide se multipliaient. Ainsi, dans les grandes réunions qui avaient eu lieu surtout à l’extérieur du pays, l’État haïtien dans toutes ses composantes, ainsi que les alliés de la communauté internationale toutes tendances confondues, avec la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH), parlaient tous d’une seule nécessité : la reconstruction. Au milieu de ce tohu-bohu, la question qui restait pendante était celle-ci : quel type de reconstruction les partenaires internationaux et les gouvernements d’Haïti envisageaient pour le pays ?
Entre-temps, pendant que des familles pleuraient encore la disparition de leurs proches, déjà, dans les grands débats médiatiques et politiques, les commentaires étaient : que faire ? Et comment le faire ? Du fait qu’Haïti depuis un certain temps est considéré comme un état failli, donc certains se disaient que c’était le bon moment pour parler de la restauration de l’autorité de l’État. Il n’y avait pas de doute, car, dans le cas d’Haïti, c’était très important puisque tout était à refaire. Mais vu les urgences du moment, et compte tenu du constat d’échec plus particulièrement de certaines tentatives déjà entreprises dans ce domaine par des acteurs locaux et internationaux, donc parvenir à la réalisation de telles démarches n’était pas pour demain. Ce qui explique que, le choix de l’État haïtien et de ses alliés de l’international d’opter pour la reconstruction des bâtiments, surtout, publics détruits lors du séisme du 12 janvier aussi bien que des maisons pour la population qui était sous les tentes un peu partout, était une décision au prime abord raisonnable.
Reconstruction, oui, mais en réalité, quel type de reconstruction voulaient-ils vraiment pour la population en particulier, et le pays en général ? Voulaient-ils reconstruire les bidonvilles tels qu’ils étaient avant le 12 janvier ? Où voulaient-ils reconstruire selon les normes parasismiques et modernes de l’urbanisation ? À savoir, l’aménagement de cités modernes pour la population, en commençant par les quartiers populaires. C’était dans cette optique que beaucoup se posaient cette question à savoir :
Pourquoi et comment construire ?
« La bidonvilisation est un phénomène lié à la précarité économique. Les facteurs historiques, politiques, économiques aussi bien que des attractions socioculturelles sont toujours les raisons prioritaires qui poussent aux constructions dans des villes. » Il est important aussi de mentionner que, généralement, derrière tout déplacement, que ce soit d’une ville à une autre ou d’un pays à un autre, se cachent presque, toujours des raisons économiques. Ce qui explique que, dans le cas des pays pauvres où il n’y a pas d’infrastructures, les gens ont toujours tendance à quitter leurs sections rurales ou leurs provinces pour aller s’établir dans les grandes villes. Phénomène qui n’est pas différent en Haïti puisque, vu l’état de délabrement des sections rurales et communales où les services de base n’existent pas, les gens, très souvent, abandonnent leurs petites communautés pour aller vivre dans les grandes villes, particulièrement Port-au-Prince, la capitale. Donc, reconstruire après le 12 janvier était une bonne occasion, si toutefois les autorités avaient la volonté de faire de la décentralisation un pilier important de l’agenda de la reconstruction.
Puisque, depuis des décennies, certaines régions dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince et d’autres communes avoisinantes continuent non seulement de s'accroître, mais aussi d’attirer les gens, donc tout ceci démontre pourquoi les autorités locales et les partenaires de la communauté internationale qui parlaient de reconstruction devraient réfléchir et penser non seulement à la modernité quant à la reconstruction dans des zones touchées par le séisme, mais procéder à une véritable décentralisation du pays aussi et du coup au décongestionnement de Port-au-Prince. Mais après de très grandes propagandes médiatiques de l’international, plus de dix ans après de grands projets de construction annoncés, la montagne a accouché d'une souris. Ce qui explique que...
La reconstruction n’a pas été au rendez-vous.
Plus de dix ans après le tremblement de terre qui avait dévasté la capitale et d’autres communes plus particulièrement dans le département de l’Ouest, la reconstruction d’Haïti tant annoncée par les autorités haïtiennes et les partenaires de l’international n’avait pas apporté les résultats escomptés. Puisque ni le Palais national ni la Cathédrale de Port-au-Prince, aussi bien d’autres bâtiments emblématiques de la capitale n’ont même pas été reconstruits. N’en parlons pas de logements pour ceux-là qui étaient sous les tentes. Et aussi, dans les villes de province, les constructions anarchiques et en dehors des normes parasismiques continuent de proliférer. Ainsi, tout en demandant les 4.2 milliard de dollars du Petro Caribe, le peuple a aussi doit de demander où est passé l’argent de la reconstruction.
Mais de toutes les préoccupations post séisme, c’est surtout, à court, moyen et le long terme, les dégâts institutionnels, économiques, et de déstabilisation du pays que causaient les résultats des élections frauduleuses imposés par le CORE GROUP.
Chronique d’une crise de déstabilisation annoncée
Le tremblement de terre n’avait pas seulement détruit les maisons de la population, des écoles, universités, hôpitaux, églises et des édifices publics, il avait aussi causé de nombreuses victimes, des morts, des blessés, et laissé un grand nombre de personnes amputées pour le reste de leurs vies. Mais, plus dix ans après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, mis à part les membres de ces amputés qui ne seront jamais remplacés, et la reconstruction de certains bâtiments et édifices publics qui, jusqu'à présent, sont encore sous les tentes ou des hangars d’urgences de fonctionnement, suivi du choléra importé, il y avait les élections frauduleuses ‘’made’’ par le CORE Group qui continuent de faire beaucoup de tort au pays. Ainsi, s’il y avait le 12 janvier 2010 comme catastrophe naturelle, quand on sait le résultat désastreux de celui qui était président après le séisme, donc on peut dire sans langue de bois que les élections du 28 novembre 2010 et de 20 mars 2011 sont définitivement un séisme d’une magnitude diabolique qui a pulvérisé les institutions du pays. Car le 12 janvier, une partie du pays était secouée, mais cette fois, avec les élections frauduleuses, c’est tout le pays qui est touché par des secousses.
Institutionnellement, le pays avait été secoué après les résultats définitifs du premier tour des élections du 20 novembre 2010 annonçant le chanteur dévergondé et la professeure d’université au second tour du processus. Haïti avait fortement tremblé quand le 20 mars 2011 le peuple avait voté Mirlande Manigat pour empêcher les vulgaires personnages de continuer à dire des sottises ou commettre des bêtises, mais quelques jours plus tard, en lieu et place des résultats du Conseil Électoral Provisoire, l'international avait passé outre pour imposer son poulain immoral, incompétent, arrogant et corrompu Michel Joseph Martelly au pouvoir.
Roromme Chantal, ancien journaliste et cadre du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) en Haïti et, professeur d’université au Canada, dans son texte Haïti dans l’œil d’un cyclone politique publié dans les colonnes du Nouvelliste en date du 25 février 2011 écrit : « Si Mirlande Manigat perd la présidentielle Haïtienne de 2011, ce ne sera pas une simple défaite électorale. Les Haïtiens auront ainsi laissé filer une opportunité en or de favoriser la renaissance du pays, l'engageant du même coup sur la voie de la modernité et du progrès. En Haïti, la qualification inattendue de Michel Martelly pour le second tour de la présidentielle de 2011 place le pays droit dans l'œil d'un cyclone politique. En effet, plus d’une redoute, dans le cas de la République caraïbe, une « mutation mortifère » qui, à moins d'un sursaut national, pourrait être irréversible... La naissance du « mickisme » Musicien reconverti politicien l'instant des élections, la percée de Michel Martelly (Sweet Micky) dans la politique haïtienne provoque une onde de choc, ressentie bien au-delà du pays. Son émergence consacre un retour en force du populisme, après une brève parenthèse, lequel est la conséquence d'un double échec. Suite au séisme dévastateur du 12 janvier 2010, la communauté internationale et le gouvernement haïtien ont échoué à mettre sur les rails le projet de la reconstruction du pays. »
À part le choléra et les élections de novembre 2010 et de mars 2011, dans son texte La résilience chez le peuple haïtien, pour commenter l’ouragan Matthew qui avait frappé Haïti en octobre 2016, Sarafina Métellus écrit : « Matthew, un ouragan de catégorie 4, a percuté les Caraïbes ainsi que certaines régions des États-Unis. Toutefois, ce cataclysme a engendré des dégâts particulièrement colossaux en Haïti et le bilan s’est avéré désastreux. Alors que certaines sources ont décrété que l’ouragan aurait causé 1000 morts, la Protection civile haïtienne estime, en date du 13 octobre, qu’environ 546 Haïtiens auraient perdu la vie. Nonobstant ces données contradictoires, le fait demeure qu’à peu près 175 000 citoyens se sont retrouvés sinistrés et en besoin urgent de nourriture, de soins médicaux et d’abris »
Le tremblement de terre du 12 janvier, le choléra, les élections frauduleuses de mars 2011, l’ouragan Matthew en octobre 2016 sont des exemples majeurs de catastrophes qui ont accéléré la descente en enfer de ce pays, mais c’est chaque jour qu’Haïti fait face à bon nombre de difficultés qui ne sont pas seulement de catastrophes naturelles, mais d’ordres institutionnels d’un État failli.
De plus, le pays est secoué très fort quand les autorités haïtiennes et alliés de l’international dans des constructions bidons, mais très couteux, dépensaient sans scrupule l'argent alloué à la reconstruction à des fins personnelles. Chaque jour, le peuple vit des secousses plus fortes que celui qui, en quelques secondes, avait frappé le pays le 12 janvier 2010. Le pays est secoué plus fort quand les 4.2 milliards de dollars des fonds du Petro Caribe sont dépensés dans 25 stades fictifs, des lampadaires qui ne faisaient pas mieux que de simples lampes à gaz pendant que le Palais national, le Parlement, l'Hôpital Général, des marchés et d'autres édifices publics sont encore, comme la population, sous les tentes.
Mais de toutes les préoccupations dans l’Haïti post séisme, la propagation des armes dans les zones défavorisées ne fait qu’ajouter une crise dans une crise dans un pays ou l’État était déjà en mauvais état de putréfaction.
La prolifération des gangs armés dans les quartiers populaires
Quand les armes sont distribuées à des jeunes dans les quartiers populaires, Haïti est secoué à chaque second au point que le pays est devenu un vaste champ de tir. Leur magnitude peut être évaluée à partir des calibres utilisés et des cartouches tirés par les gangs et hommes de main des dirigeants qui sont des anciens membres du mouvement paramilitaire durant le coup de force de septembre 1991. Ces anciens membres de FRAPH qui ont aujourd’hui un mandat légal pour frapper peuvent faire trembler La Saline, Cité Soleil, Carrefour-feuille, Pont Rouge, Bel-Air et Martissant et autres zones défavorisées selon leurs tendances politiques dans les mouvements de mobilisation pour destituer les voleurs de l'argent des fonds du Petro Caribe au pouvoir, les juger, et en finir avec le système corrompu dans le pays.
Après le tremblement de terre, qui avait détruit certains édifices publics, écoles, hôpitaux, magasins, maisons, et tué des centaines de milliers en quelques secondes, les dirigeants haïtiens post séisme 2010 n’avaient pas trouvé des moyens plus efficaces pour prévenir une ruine totale que de distribuer de l’argent et des armes aux gangs pour continuer à massacrer dans les quartiers populaires. Chaque jour, à chaque seconde, avec le bruit des armes automatiques dans les quartiers populaires, le peuple vit les secousses des tremblements de terre avec une magnitude si forte capable d'ôter la vie en quelques millisecondes. La différence entre celui du 12 janvier et le bruit au quotidien de cartouches et des tueries, c’est que ces derniers visent seulement les pauvres dans les quartiers populaires comme La Saline, Carrefour-feuille, Martissant, Pont-Rouge et Bel-Air etc.
Si le tremblement de terre du 12 janvier 2010 avait détruit, physiquement, bon nombre d’édifices publics de Port-au-Prince, par contre les élections volées et imposées des parlementaires de la cinquantième Législature font, pendant plus de quatre ans, à chaque séance, trembler non seulement la capitale, mais tout le reste du pays. Et c’est la grande différence, puisque le tremblement de terre avait, en quelques secondes, frappé Port-au-Prince et certaines villes proches, mais la corruption et autres actes de malversations impliquant bon nombre de parlementaires de la 50e ont secoué nationalement tout le système de l’éducation, de santé, de l’emploi, de sécurité, et tout le reste. Ces messieurs les honorables parlementaires de la cinquantième Législature, dans leurs actes déshonorables de manipulations et de corruptions de toutes sortes, ils étaient si maladroits même le mal ils le faisaient mal.
La 50e Législature, une catastrophe institutionnelle, unique à elle seule
N’en déplaise à un petit groupe de parlementaires qui sont dignes du nom d’honorables, le reste n’est qu’une troupe de déshonorables qui ont leurs places dans les poubelles de l’histoire. Dans un rapport sur les élections de 2015, publié le mardi 2 juin de cette même année, le Réseau national de Défense des Droits Humains (RNDDH) questionne la moralité de certains candidats, dont 35 candidats (4 au Sénat et 31 à la députation) en lice seraient de moralité douteuse. « Trente-cinq candidats aux législatives sont pointés du doigt dans ce rapport non exhaustif du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) qui a révélé certains faits troublants portant spécifiquement sur la moralité des candidats aux législatives et qui est de nature à inquiéter tous les citoyens haïtiens. En effet, certains citoyens en conflit avec la loi se sont portés candidats en dépit du fait que le décret électoral leur fait exigence de se munir d’un certificat prouvant qu’ils sont de bonne vie et mœurs. Les candidats mentionnés dans le rapport ont été contraints par la justice pour des motifs divers tels qu’assassinat, escroquerie, abus de confiance, cas de violence, agression et voies de fait, enlèvement, vol, viol, usage de faux, association de malfaiteurs, trafic illicite de stupéfiants, détention illégale d’arme à feu, corruption, vol de propriété, entre autres. »
Puis vint le 7 juillet et le 14 août 2021
Les dix dernières années sont donc riches, malheureusement en rebondissement négatif pour le pays. Il y avait le meurtrier tremblement de terre du 12 janvier 2010, suivi du choléra importé et des élections frauduleuses made USA. Depuis, c'est la débandade.
Sous les regards insouciants et impuissants des dirigeants, des gens ont été kidnappés, violés et assassinés, y compris un président en fonction. Oui, chez lui en sa résidence privée dans la nuit nuit du 6 au 7 juillet 2021.
Après l’assassinat du chef de l’État, sous l’influence de l'international, bien entendu avec le CORE GROUPE, tout en imposant un Premier ministre de facto, la déstabilisation du pays continue.
Boom, il y eut le 14 aout 2021. Avec ce séisme, le Grand Sud réveillait sur le choc. Comme lors du 12 janvier 2010, l'État était impuissant.
C’est cette impuissance généralisée de l’État qui avait motivé Joseph Wendy Alliance dans son texte L’insécurité: ce cancer qui mérite d’être traité en toute urgence, a fait une radiographie du problème de l’insécurité en Haïti.
Selon le jeune politologue «L’ère Jovenel Moïse dont le relais final post-mortem avec l’écartement en douceur des « Jovenélistes » est assuré par le Premier ministre Ariel Henry, plus que toute autre chose, est dominée par une succession d’images sanglantes de victimes de tout genre et de tout âge livré à la barbarie de bandits sans foi ni loi à la barbe d’un État presque à dessein je-m’en-foutiste. Au cours des dernières années, le banditisme érigé en option préférentielle de mode d’exercice du pouvoir politique a transformé les massacres, les kidnappings, les assassinats sur la population haïtienne innocente en faits divers. Cette banalisation de la violence avait atteint un moment épique avec l’assassinat tragique du président Jovenel Moise en juillet dernier, ce dernier, rappelons-le durant son règne en chair et en os, n’ayant jamais mesuré l’urgence de résoudre véritablement le problème persistant et brûlant de l’insécurité. »
Très profond dans ses analyses, Joseph Wendy Alliance écrit que « Le ton, sur la question de l'insécurité, malheureusement n’a pas change avec le Premier ministre Arie Henry aux commandes. Les cas d’assassinats, de kidnappings se multiplient au quotidien et le gouvernement actuel remanié en bonne partie avec des anciens opposants acharnés au président Jovenel Moïse, ne donne aucun signe jusqu’à présent qu’il va prendre les mesures pour juguler ce phénomène. Par exemple, de juillet à septembre 2021, selon un rapport d'enquête de la Cellule d’Observation de la Criminalité du Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH), environ 221 cas d'enlèvement ont été recensés en Haïti. D'après ce même rapport, le taux de kidnapping avait enregistré une hausse de 300% de juillet à septembre. »
On dit souvent que le peuple haïtien est très résilient. C’est-à-dire individuellement ou collectivement, les Haïtiens ont « la capacité de se développer bien, à continuer à se projeter dans l’avenir en dépit d’évènements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères » (M. Manciaux et coll., 2001).
À ce titre, Nicxon Digacin, dans son texte Et si les Haïtiens étaient un peuple résilient, pense que : « Pour un peuple résilient, chaque catastrophe, chaque tragédie est une opportunité d’innover, de créer, de devenir plus fort et mieux muni contre les adversités. » Mais, combien de tragédies naturelles ou institutionnelles devraient frapper Haïti pour que les dirigeants de ce pays puissent dans un élan de solidarité nationale comme dans le cas de Paul Kagame au Rwanda penser ou agir autrement au lieu de continuer comme des bandits légaux à être les fossoyeurs de la nation tout en quémandant la pitié de l’international ?
Puisque, depuis le séisme du 12 janvier 2010, du choléra, des élections frauduleuses post tremblement de terre, de l’ouragan Matthew, de l’élection à l’assassinat crapuleux de ‘’nèg bannan’’ suivi quelques semaines plus tard du séisme meurtrier du 14 août 2021 dans le Grand Sud, les Haïtiens sont devenus, à cause des autorités corrompues, incompétentes et arrogantes imposées par des alliés de l’international et supportées par l’oligarchie économique locale, plus pauvre et plus vulnérable. Le lourd bilan laissé par les deux administrations issues des deux dernières élections générales aussi bien des accords mal accordés de l’actuel Premier ministre de facto dans le pays est comparable à un ouragan qui, avec vent, pluies intenses, coulée de boue, ravage tout sur son passage comme par exemple : les familles, les institutions publiques et privées, l’économie, les plantations, les animaux, les régions côtières et panne d’électricité. Cet ouragan tue et détruit tout.
N.B : Ce texte est la version corrigée et adaptée à partir d’un article qui, il y a quelques années de cela, avait été publié dans des journaux en Haïti et aux États-Unis.
Prof. Esau Jean-Baptiste